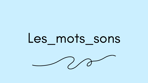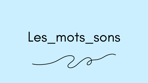C'est un souvenir soleil.
Le printemps qui vient.
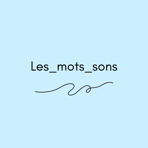

Je pensais à cela, la semaine dernière, sur le chemin du travail. Cette route mille fois arpentée, connue par coeur, en pilotage automatique, qui me permet l’aventure dans les tréfonds de mon absconse pensée. Je pensais à cela, donc, alors que je serpentais entre les champs de colza qui dansait. Ailleurs. Ces morceaux de soleil à portée de doigts, encore hésitants aux prémices du printemps. Ils me replongeaient malgré moi en ce sacro-saint temps du confinement. Cette période suspendue entre un réel effrayant et un flou épais.
J’étais au volant de ma voiture, au milieu des champs de colza et je les voyais. Je les voyais. Enfin. Pour de vrai. Et comme un refrain, ils m’apportaient la musique de nos pas au milieu des broussailles, le rire de mon fils qui retrouvait l’air printanier, la lumière sur la peau qui dessinait la vie, la douceur d’être à trois. Et le temps qui s’étend et qu’il faut savourer. Nous étions raisonnables, braves petits soldats, et respections à la lettre les consignes gouvernementales. Aussi, chaque jour, pendant une heure, soixante minuscules minutes, nous partions à travers champs - un kilomètre autour de la maison - le palpitant à vif de pouvoir prendre l’air. Le même trajet. Inlassablement.
Et c’est ainsi que nous avons pris le temps. Celui de regarder fleurir le colza.
J’ai grandi au milieu du colza. Et du blé. Et du lin. J’ai grandi au milieu des champs. Je l’ai vu fleurir chaque année, envahir l’horizon, amener un peu de gaité aux mornes paysages des plaines du Nord et ce fumet si particulier à l’air ambiant. Rebutant, souvent. Le colza, c’était juste un décor. Quelque chose sur laquelle je ne m’attardais jamais. C’était là. Je le savais. Et peut-être bien qu’on s’habitue tellement à tout ce qui nous entoure qu’on finit par ne plus rien voir. J’étais devenue aveugle. Cécité des gens pressés. Ces affamés qui ne savent plus déguster. Vite. Consommer. J’avais oublié de le regarder pousser. De l’observer éclore. De le contempler jaunir.
Ces quelques mois en ermite, forcés, m’ont permis ça. Voir renaître le colza. Et me sentir renaître aussi. Quitter ma carapace lourde de l’hiver qui étouffe et me mettre à fleurir. Me réveiller de mon long sommeil, le corps tétanisé, tremblant.
Le colza, ma lucarne lumineuse.
Ma fenêtre sur le printemps et la douceur du répit qui s’annonce.
J’étais au volant et je serpentais au milieu des champs de soleil. Prête à reprendre mon souffle, enfin.