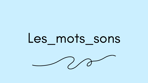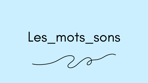C’est un constat.
Et il me broie.
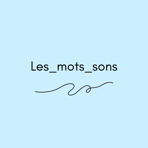

Un chat famélique a traversé la rue. Et quand je dis « traversé », je ne dis pas qu’il a bondi, habile, félin, malicieux, vigoureux, non, il a soulevé péniblement une patte après l’autre, indifférent au trafic automobile. Las. Comme usé jusqu’à l’os. « Qu’ils attendent, je ne peux pas aller plus vite. » Alors j’ai attendu. Pied sur le frein je l’ai regardé avancer comme s’il se traînait jusqu’à l’échafaud, laborieusement. Douloureusement. Et une vague de chagrin m’a submergée. Qu’a-t-il bien pu arriver pour que cette pauvre bête se retrouve dans cet état cadavérique, les os saillants sous le pelage poisseux et terne, le regard lointain? Une vague de chagrin m’a submergée, oui, et mon irrépressible syndrome du sauveur est revenu frapper. Boomerang. J’ai dit au mari « On ne peut pas le laisser comme ça, viens, on l’emmène, on lui donnera un bol de ces croquettes très chères qu’on donne au nôtre, ce bon gros chat roux replet, qu’on bichonne et qu’on aime… oh oui mon gros chat à sa maman… » (j’ai la tendance gaga facile avec ce tigre-là…). Et pourtant vous savez quoi? Je n’aime pas beaucoup ça, moi, les animaux. Je ne suis pas de ce genre qui se pâme devant un chiot qui gigote ou une photo de chaton craquant. J’aime le mien. Parce que c’est le mien. Je ne les déteste pas, non, mais ils m’indiffèrent (et me dégoûtent un peu… tous ces poils et cette bave… Je ne sais même pas si j’aurais été capable de le toucher, lui, le répugnant fauve cabossé) « Prends ça dans le nez! Ils ne t’indiffèrent rien du tout! Regarde toi avec ta peine pour cette pauvre bête décharnée. Ton coeur se serre au point de te faire mal. T’as l’air maline maintenant. » a dit la petite voix dans ma tête.
...